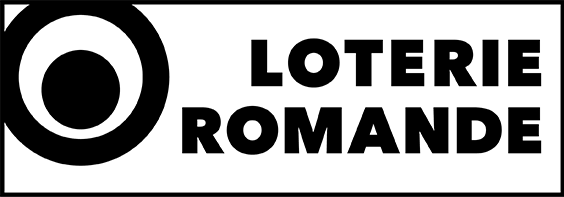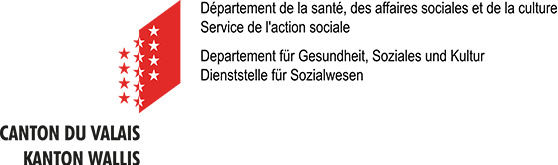Dans le cadre des publications de « Rhizome », nos collaborateurs vous proposent des témoignages, des entretiens avec des chercheurs ainsi que des chroniques. Découvrez la première partie du témoignage de Lise, une maman qui a vécu le départ de son fils vers une zone jihadiste.
En une journée ensoleillée de cette période si spéciale que nous vivons tou.te.s, Lise* accepte de témoigner par médias interposés. C’est une maman comme les autres, ou presque. Juin 2015, son fils prend une décision irréversible : partir « défendre les musulmans et la Oumma afin de faire tomber Bachar el-Assad ». Loin du tumulte médiatique dans lequel se retrouvent certains parents concernés, Lise nous partage son récit, constellé d’amour, de questionnements en suspens, de doutes, de détermination et d’espoir, mais surtout traversé par une extraordinaire prise de recul. Sorte d’électron libre dans ce monde qui est maintenant le sien, elle ajoute de la nuance à un phénomène trop souvent sujet à des généralisations excessives.
Voici son histoire.
Je t’aime moi non plus
« Mon fils, il n’en faisait qu’à sa tête ». C’est une personne avec du tempérament, « parfois une teigne » que Lise décrit lorsqu’elle se remémore l’adolescence de son fils. Ses études, il aurait pu les réussir s’il avait croché, mais les fréquentations n’ont pas beaucoup aidé. S’il est classé dans la catégorie « délinquants » suite à deux séjours en prison, Lise insiste pour ne pas caricaturer ceux qui sont partis, « dire qu’ils ont tous été en prison et fumaient des joins n’est pas la réalité non plus ». Pour cette maman, c’est aussi un état d’esprit qui a évolué plus tard adulte. Jeune entrepreneur, les aides manquent et la vie est chère. Quelques années avant son départ, son souhait était de s’installer en province dans une grande maison où la famille se serait rassemblée pour une vie « plus calme et moins risquée ». Cette vision et projet de vie résonnent d’ailleurs pour Lise en totale contradiction avec l’abandon par la suite du « confort et de la consommation ». Tous deux n’ont pas une personnalité à se confier facilement, ils sont indépendants et pudiques dans leur relation mère-fils. Pourtant, les futurs échanges qu’ils auront à des kilomètres de distance les rapprocheront parfois, tout comme Lise s’ouvrira à certaines personnes (autres parents, chercheurs, etc.) qui l’aideront et la soutiennent encore aujourd’hui dans sa quête perpétuelle de réponses et de connaissances.
Maman, je veux faire le Ramadan
L’islam pour Lise, c’est une religion de paix et de solidarité, et c’est aussi une des deux religions de la famille : le côté de Lise se réclame plutôt du catholicisme, le père de son fils et ses grands-parents paternels sont musulmans. Alors quand son fils lui déclare à douze ans qu’il commence à pratiquer le Ramadan, elle lui répond « pas de souci mais je ne me lèverai pas le matin pour te faire à manger ! ». La religion musulmane, il apprend à la connaître avec ses grands-parents en vacances, son père quelques fois et avec le « phénomène copains » comme le nomme Lise. Sans certitude, elle suppose que c’est aussi avec ses amis, tous de confession musulmane, que son fils a découvert l’islam et acquis de l’expérience à ce sujet. Son premier jeûne dure deux ou trois jours, puis il arrête, parce qu’il faut se lever très tôt et que ce n’est pas facile lorsqu’on est adolescent, « surtout si la maman n’est pas musulmane ». Il essaie à nouveau l’année suivante quelques jours durant mais ne tient pas une semaine entière. Pour Lise, la religion ne revêt pas d’importance particulière et ce n’était pas le sujet à la maison : elle est toujours partie du principe que son fils pouvait choisir une religion, qu’elle n’avait pas à lui en imposer une. En revanche, si son fils souhaitait faire le Ramadan, cela ne voulait pas dire « je fais le Ramadan la journée et le soir je fais toutes les conneries possibles et imaginables ». Le « phénomène copains » la laisse donc parfois perplexe, mais mise à part le Ramadan, son fils ne prie pas et ne partage pas spécialement son rapport à la religion : « il disait juste qu’il était musulman et c’est tout, ça n’allait pas plus loin ». De fait, Lise ne comprend pas pourquoi on parle souvent de « conversion » ou de « reconversion » lorsqu’il s’agit de faire le choix entre deux religions « d’origine ». De son point de vue, son fils ne s’est pas converti, « il a choisi une religion ». Cette période d’adolescence et d’exploration religieuse ne suscite dès lors aucun questionnement ou doute pour Lise, voyant dans la pratique de son fils un choix qui « coule de source » au vu des deux religions connues au préalable. Les réflexions sur les mots mêmes à employer ainsi que les nuances à apporter à son histoire et à celle de son fils balaient en fait le témoignage entier, et c’est aussi à travers une grande remise en question de ses propres choix que Lise nous relate le « basculement » et le moment du départ.
Pour moi, c’était impossible que mon fils puisse partir
Lors de la seconde incarcération de son fils, Lise refuse d’aller le voir, « l’erreur ne pouvait pas arriver une deuxième fois ». Elle perçoit cette période comme l’élément déclencheur, le basculement qui, selon elle, conduira son fils à faire le choix de partir quelques années plus tard. Si globalement son discours, ses fréquentations et sa façon de vivre n’ont pas changé, son fils intègre pour la première fois des prières dans sa vie quotidienne. Habitant encore chez Lise à cette époque, il est un jour injoignable et lui apprend qu’il était à la mosquée en train de prier. Une autre fois alors qu’il se trouve dans sa chambre, elle l’appelle sans succès jusqu’au moment où il lui dit qu’il priait et ne l’entendait pas, choses qu’il ne faisait pas avant ce second séjour en prison. Plus tard, la police expliquera à Lise que la « radicalisation » a commencé non pas en prison, mais par le biais de la fréquentation d’une mosquée, pour finalement décréter après enquête qu’il aurait décidé de partir « lui tout seul, à la manière d’une sorte de loup solitaire » – même si cette expression est souvent remise en question dans un contexte jihadiste. Si Lise reste convaincue que la prison n’y est pas pour rien, c’est aussi parce qu’elle s’interroge après coup sur ses propres agissements : « il s’est mis à prier parce que je ne suis pas allée le voir, donc en fait je me suis dit que c’était peut-être ce qui avait été l’élément déclencheur, qu’il avait compensé mon absence par autre chose ».
Du jihadisme, Lise ne connaît pas grand chose à ce moment-là. Elle en a entendu parler par une amie et évoque comme tout le monde l’Afghanistan, les Talibans et Oussama Ben Laden, « ce qu’on entendait aux informations mais ça s’arrêtait là, et ça ne m’intéressait pas plus que ça ». Lorsque sa belle-fille la prévient un soir de juin 2015 que son fils est parti en Belgique pour le travail et qu’il n’a pas donné de nouvelles, Lise pense de suite à un accident de voiture. Le lendemain, il appelait sa femme pour lui annoncer qu’il était en Syrie. Essayant de le joindre en vain, c’est finalement par l’intermédiaire de sa belle-fille que Lise reçoit un message de son fils. Il lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il la contactera plus tard, et garde ensuite le silence durant plus d’un mois et demi. La Syrie, Lise l’associe directement à la mort, puis à l’incompréhension : « on se pose plein de questions, et en même temps on ne comprend pas ce qu’il se passe, on ne sait pas pourquoi et on se demande surtout si c’est vrai ». Elle est pourtant vite rattrapée par cette réalité lorsque la police lui annonce de but en blanc : « c’est clair, on ira pas le chercher ».
Prise dans un tourbillon d’informations et de questions de la part des autorités, elle a besoin de temps pour tout assimiler. Elle apprend que son fils est parti en train, les escales qu’il a faites, ainsi que la grande somme d’argent qu’il avait sur lui lors de son départ. « Je n’arrivais pas à réaliser, ça me paraissait irréel et du coup je me posais encore plus de questions, parce que mon fils est parti avec beaucoup d’argent. Il a fait beaucoup d’achats avant de partir avec des sommes importantes […] J’avais ce décalage entre les sommes dérisoires que je proposais pour l’aider et les sommes qu’on m’a annoncées ». En fait, Lise ne saura jamais par la suite la provenance exacte de cette somme d’argent, à part l’existence d’un chèque, et suppose qu’il y a eu un financement à un moment donné, l’entreprise de son fils ne dégageant pas assez de bénéfice pour un tel montant. Sur ce point-là aussi, la police ne lui en dira pas plus.
Au cours du long mois et demi qui suit le furtif message de son fils, Lise se pose de multiples questions, pour beaucoup encore en suspens : « Pourquoi est-il parti ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Quel était l’élément déclencheur ? Pourquoi partir du jour au lendemain ? ». Lorsqu’elle aura enfin l’occasion d’être à nouveau en contact avec lui, elle accède à quelques éléments de réponses : « la première question que j’ai posée, c’était de savoir si c’était de ma faute, ça a été ma première question ». Son fils lui répond que « c’était par rapport à tout ce qui se passait en Syrie, Bachar el-Assad on pouvait pas le laisser faire et que c’était pour défendre les musulmans là-bas ». Contrairement aux « raisons humanitaires » fréquemment revendiquées comme motifs des départs, c’est la volonté militante que Lise fait ressortir avec le discours de son fils, et plus largement un projet politique, dans lequel s’inscrit le jihadisme.
(« L’instant cigarette » de Michèle Lescuyer – Artmajeur.com)