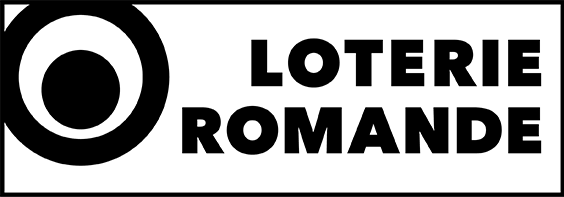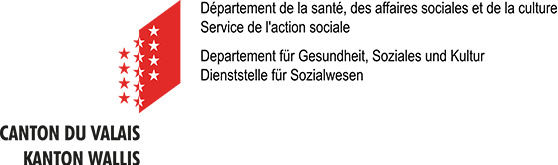Répondre aux inquiétudes de la société
Selon Jeanne Prades, doctorante française en Science politique qui vient de publier un article sur le sujet dans The Conversation, il existerait bien une exception mais pas là où les Français la voient. « La comparaison européenne, indique-t-elle, fait apparaître que la singularité française ne réside pas dans les fondements historiques de sa laïcité mais dans son invocation récente face aux inquiétudes de la société ».
En d’autres termes, ce qui distingue la France d’autres pays européens, n’est pas tant sa laïcité, comme on l’entend souvent, mais l’usage qui en est fait face aux inquiétudes de la société à l’égard du religieux et plus particulièrement de l’islam. En effet, Jeanne Prades rappelle que les grands principes de la laïcité française – la liberté religieuse, l’égale citoyenneté, la non-discrimination – ont été largement adoptés par les pays européens en voie de sécularisation au 19ème siècle, qu’ils se réclament ou non de ce principe. La laïcité est en effet une modalité parmi d’autres, d’un processus commun fondateur de la modernité européenne et qui entraîne progressivement une séparation des sphères politiques et religieuses dans l’émergence des démocraties modernes.
Une »Nouvelle laïcité »
En revanche, souligne la chercheuse, l’exception réside dans la mobilisation d’une « nouvelle laïcité » depuis les années 2000, se faisant progressivement symbole de « l’identité nationale », « rempart contre la menace terroriste » ou instrument de lutte pour l’égalité entre hommes et femmes. L’expression « nouvelle laïcité » fait précisément son apparition dans le contexte de la première controverse en France sur le port du voile à l’école publique (1989).
« Cette « nouvelle laïcité » apparaît donc comme un cadre d’interprétation spécifiquement français des enjeux socioculturels, identitaires et sécuritaires liés à l’islam » qui serait, selon Jeanne Prades, le produit d’un double legs historique : celui de l’anticléricalisme d’une part, où la religion est vue comme un symbole d’irrationalité et de soumission, celui de l’héritage colonial d’autre part, dans sa perception spécifique de l’islam.
Pour aller plus loin :
- David Koussens, « Ce que la laïcité a de nouveau, ou pas. Regards croisés France-Québec », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 12 juin 2018, consulté le 24 janvier 2020.
- Sandrine LEMAIRE, Nicolas BANCEL, Pascal BLANCHARD, La fracture coloniale, La société française au prisme de l’héritage colonial, LA Découverte, 2006